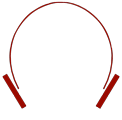Interview Frédéric Sanchez by Theophile Picard
THANK YOU FOR THE MUSIC
D’abord la sonnerie de cette porte en fond de cour du Xe arrodissement, les pre- mières notes de «Let’em In», une évidence…Puis des murs couverts de disques, et enfin, au sous-sol, je retrouve, plongé sur ses machines, Frédéric Sanchez, maestro de défilés des plus grandes maisons de mode. Nous parlerons des évolutions de sa pratique depuis les années 80, les grandes influences de sa culture musicale, ses relations aux designers et comment
faire d’un défilé une œuvre complète.
TP : Bonjour Frédéric, avant tout de chose, pou- vez-vous me parler de votre parcours musical person- nel, comment avez-vous découvert la musique et les artistes qui vous ont influencés ?
FS : C’est vaste, ça a commencé enfant même si il n’y avait pas ou peu de musique chez mes parents. Par ha- sard, je devais avoir 7 ans, je suis tombé sur un disque des Beatles, Abbey Road. J’aimais bien la pochette avec les fab fours qui traversent la rue. Mais j’étaits aussi fasciné par la légende qui l’entourait. McCartney pieds nus, le numéro de la plaque d’immatriculation, le costume blanc… J’étais autant intéressé par la my- thologie autour que la musique en elle-même. Ensuite j’ai été très marqué par ces artistes qui déve- loppaient un imaginaire, une histoire. Donc bien sûr toute la musique progressive des années 70. J’ai grandi avec Genesis et ces groupes-là. Puis la vague de l’école de Canterbury (Soft Machine, Caravan, Matching Mole). Et enfin Brian Eno qui m’a emmené à David Bowie. Vers 12 ans, j’adorais Station to Station.
Je m’intéressais aussi beaucoup au théâtre d’avant- garde. Je demandais à aller voir des pièces où la mu- sique avait une importance. C’était l’époque de Patrice Chéreau, Peter Stein, Michael Bruber, toute cette gé- nération de metteurs en scène de théâtre qui faisaient aussi de l’opéra. Puis bien sûr le cinéma, j’ai d’ailleurs découvert l’opéra avec Excalibur de John Boorman et sa bande son wagnerienne.
TP : J’ai vu que vous aviez fait un mash-up avec Wa- gner et New Order, une bonne synthèse de vos in- fluences.
FS : Oui c’était pour Prada. Je reviens souvent au clas- sique. Ça ouvre un imaginaire très intéressant.
Après bien sûr il y a eu le punk mais je préfèrai ce qui est arrivé ensuite, la new wave et la cold wave. C’était des artistes qui avaient, pour beaucoup, fait des écoles d’art. Il y avait ce dénominateur commun, Eno et Bowie par exemple. Je crois que ce sont des musiciens qui avaient un pied dans autre chose. Et la musique m’a aussi permis de faire ma propre culture.
TP : Et donc la mode ?
FS : La mode c’est venu plus tard. Quand j’ai décou- vert qu’il pouvait y avoir des liens avec la musique. Factory Records par exemple avec Peter Saville qui faisait à la fois les pochettes de Joy Division et les ca- talogues de Yohji Yamamoto. À l’époque, j’étais sur- tout intéressé par la danse et notamment le travail de Régine Chopinot. C’était au Théâtre Contemporain de la Danse, initié par Jack Lang. Chopinot était très liée à Jean-Paul Gaultier qui faisait les costumes de ses balais.
Puis j’ai commencé à découvrir des choses qui me plaisaient ; Gaultier par exemple mais aussi les ja- ponais, Issey Miyake ou Yamamoto. En allant à leurs défilés dans les années 80, j’entendais des musiques que j’aimais. Je trouvais ça assez dingue qu’ils puissent utiliser ça. Je n’avais pas encore fait le lien avec l’idée d’en faire mon métier. J’en suis venu à la mode par la musique, la danse et le théâtre.
TP : Et comment ça a commencé ?
FS : Initialement je voulais travailler dans la danse. Je devais faire une classe prépa, j’étais au lycée Henri IV mais j’ai dit à mes parents que je voulais tout arrêter leur ai annoncé que j’avais trouvé un stage. Je suis donc rentré au service de presse du théâtre du Chatelet. Je suis devenu assistant d’une attachée de presse qui s’ap- pelait Michèle Montagne. Dans les bureaux je passais des disques, New Order, Jesus & The Mary Chain… Et un jour Martine Sitbon appelle Michelle en disant avoir un problème avec le type qui passait la musique et Michelle lui a dit « Tu sais tu devrais demander à Frédéric il s’y connait hyper bien. ». Et finalement j’ai rencontré Martin Margiela et a démarré une collabo- ration artistique très naturelle.
TP : Avant les années 80, c’était les designers eux -même qui programmaient la musique ?
FS : Je ne sais pas trop, j’imagine. Il y avait Laurent Go- dard qui faisait ça beaucoup. Mais avant c’était plutôt de l’accompagnement. YSL et la Callas par exemple, Vivienne Westwood m’avait fait toute une théorie après être allée voir un défilé Saint Laurent. Elle di- sait que c’était comme de la «musaque», une musique d’ambiance, pas très forte et c’était ça qui l’intéressait. Elle ne voulait plus que travailler avec du classique.
TP : Ce n’était donc pas encore cette idée d’œuvre complète où la musique, les vêtements et le set for- ment un tout. Et lorsque vous recevez une nouvelle commande, comment commence votre travail ?
FS : J’essaie toujours de parler avec le designer, c’est ce qui m’intéresse le plus, la dimension immatérielle. Souvent il me montre des vêtements, des moodboard. Ensuite, de mon côté, je travaille beaucoup à partir d’inspirations visuelles surtout lorsque je compose. Pour l’exposition Gainsbourg par exemple, je suis parti de son disque avec Deneuve, puis des photos de Newton et une série de l’été du Nouvel Obs afin de me constituer un mur de références et progresser à partir de ça. Je travaille en arborescence.
TP : Et vous vous intéressez à ce que le designer écoute personnellement ?
FS : S’il m’en parle oui mais ça n’arrive pas souvent. Il y a peu de créateurs qui sont vraiment férus de musique. Il y en a bien sûr, Marc Jacobs par exemple, Martine Sitbon, Anna Sui.
Je fais une grande différence entre les créateurs et les créatrices en ce qui concerne la musique. Et en par- ticulier les femmes qui créent leur propre maison, je pense à Jil Sander, Muccia Prada. Elles n’ont peut-être pas forcément un goût particulier pour la musique mais elles ont une vision globale comme si elles amé- nageaient leur maison. La musique a une place par- ticulière. Là où, chez les créateurs masculins, ça re- lève plus du fantasme. Chez les femmes c’est vraiment un truc qui habite l’espace. Chez Jil Sander c’était in- croyable.
C’est des gens qui font plus que de la mode.
TP : Vous avez souvenir d’un défilé ou d’une collabo- ration qui a été atroce ?
FS : Plusieurs même. J’ai eu une fois un épisode très embêtant avec Marc Jacobs pour Vuitton. Il travaille beaucoup avec de la musique et en général un seul et même morceau qu’il passait en boucle. À la façon de Steven Meisel qui cherchait comme ça à rendre les gens fous pour qu’il se passe quelque chose sur les photos.
Et Marc avait un peu ce truc complètement obses- sionnel. Il y avait donc ce morceau et on commence à travailler mais je me rends compte la vieille du défilé que Gucci avait utilisé le même morceau une semaine plus tôt.
Donc je suis allé le voir et je l’ai prévenu, surtout qu’à l’époque il y avait beaucoup de problèmes entre LVMH et Kering. Il m’a fait une crise d’hystérie qui a duré toute la nuit, il ne voulait rien.
TP : Ça s’est arrangé finalement ?
FS : Oui, on a fini par trouver une solution à 7h du ma- tin. J’ai d’autres anecdotes comme ça mais celle-ci je m’en souviens encore, c’était particulièrement violent.
TP : Et vous vous souvenez du morceau ?
FS : Un genre de « Voulez-vous Couchez Avec Moi ce Soir » repris par Destiny Child, une daube en plus (rires).
Non ce qui est vraiment compliqué c’est quand la per- sonne en face de vous est complétement vide. Même si on peut toujours inventer n’importe quoi, tout ça c’est faire mentir, emballer. Il faut raconter une histoire, du storytelling et ça les marques l’ont compris dans les années 90.
TP : Et le digital a changé des choses ?
FS : Totalement, les défilés live et la nécessité du stream sont apparus il y a dix ans. Je disais alors aux marques qu’il fallait faire autre chose. Le media évoluait et les attentes avec. Les marques étaient dubitatives, on a donc commencé à mettre un seul morceau qu’on al- longeait pour le digital mais ça marchait pas bien. J’ai donc fait évoluer mon travail : j’ai du me mettre à la composition Je créais alors de la musique spéciale- ment pour le live, dans l’esprit de ce qu’on entendait pendant le défilé, à cause des droits de diffusion bien- sûr.
Ça fonctionnait plutôt bien mais les maisons n’avaient pas de budget pour ça. Puis avec l’arrivée du Covid les maisons ont fini par allouer des budgets dédiés. Mais c’est devenu très basique, les morceaux étaient clearés et les marques ne regardaient plus que le nombre de vues.
TP : C’est terrible de ne plus pouvoir inscrire la collec- tion dans une époque, une esthétique avec des mor- ceaux existants, en tout cas pour le digital, c’est souli- gner un peu plus les limites du support.
FS : Exactement, on est aujourd’hui dans une logique télévisuelle de prime time et on y perd beaucoup. On perd une âme et puis les quatre mille personnes qui regardent le live n’en ont rien à faire. Et d’ailleurs la plupart des musiques, si vous regardez sur le site des marques ne sont pas publiés ou cités.
TP : Et en association farfelu, un fait d’arme dont vous êtes particulièrement fier ?
FS : Dans les années 90, j’ai fait des trucs très rigolos, y avait plus de liberté et on s’amusait vraiment beau- coup.
Pour Véronique Leroy j’ai fait des trucs très très din- gues. C’était les premières séries mode de Inez & Vinoodh. Ils avaient fait cette série dans le Face de femmes très corporate façon secrétaires de direction. J’avais donc vu ça et l’esthétique avait beaucoup plu à Véronique Leroy. En discutant on se dit qu’une telle femme doit aimer la télévision, on a donc fait une bande son avec que des génériques d’émissions façon JT de 20h ou Drucker. Le rendu était complétement cinglé !
« On est ajourd’hui dans une logique télévisuelle de prime time. »
Dans la même veine, pour une collection de Jean Colonna qui s’intitulait « la Chambre », on avait fait une bande son composée des morceaux du standard des taxis bleus. La collection s’inscrivait dans cette mouvance réaliste des années 90. Il y avait des pho- tos de Nan Goldin au mur et cette esthétique un peu trash. C’était l’histoire d’une fille dans sa chambre à cinq heures du matin qui cherchait un endroit un peu louche pour terminer la soirée. Le lendemain Steven Meisel a appelé, il voulait tout ! Le décor, les vête- ments, la musique pour faire un shoot pour le Vogue italien.
C’est la meilleure représentation de l’intérêt de mon métier et de comment je le perçois ; inspirer les gens pour six mois.
TP : Pour finir, un morceau que vous écoutez en boucle en ce moment ?
FS : Non pas vraiment, j’ai mon piano surtout.